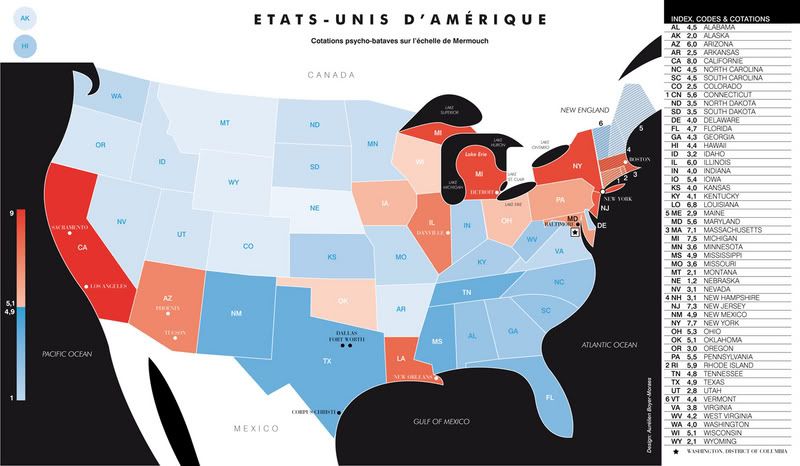
La voir en plus grand ici
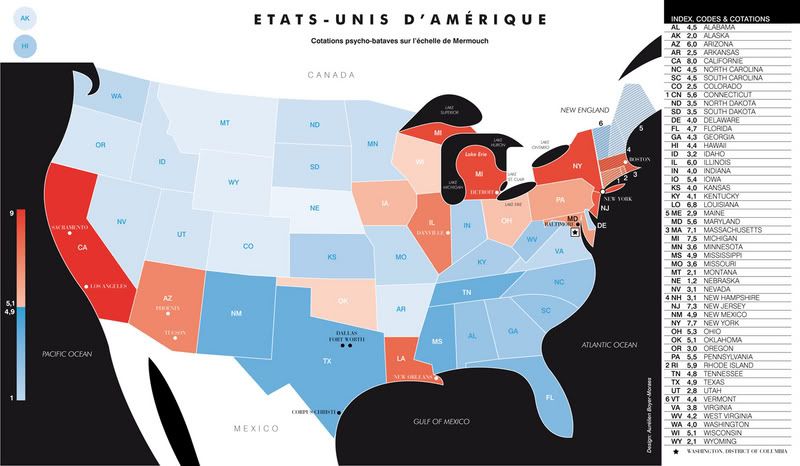
La voir en plus grand ici
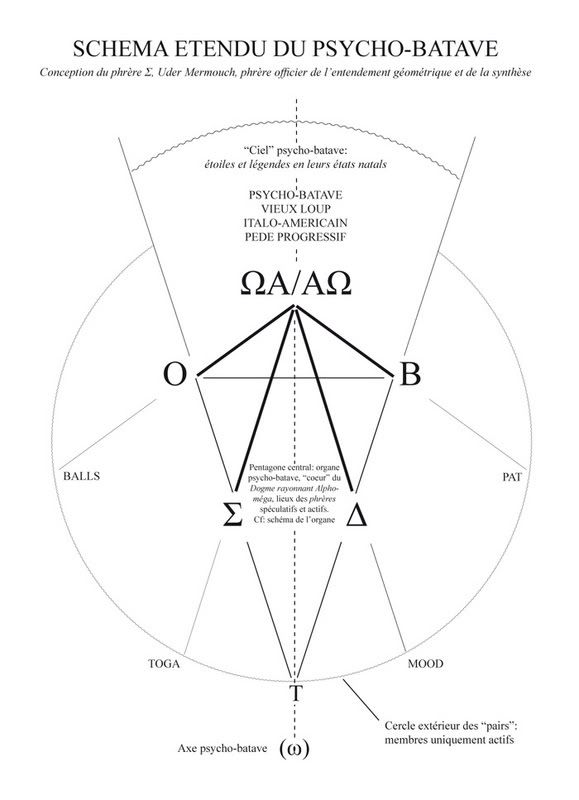
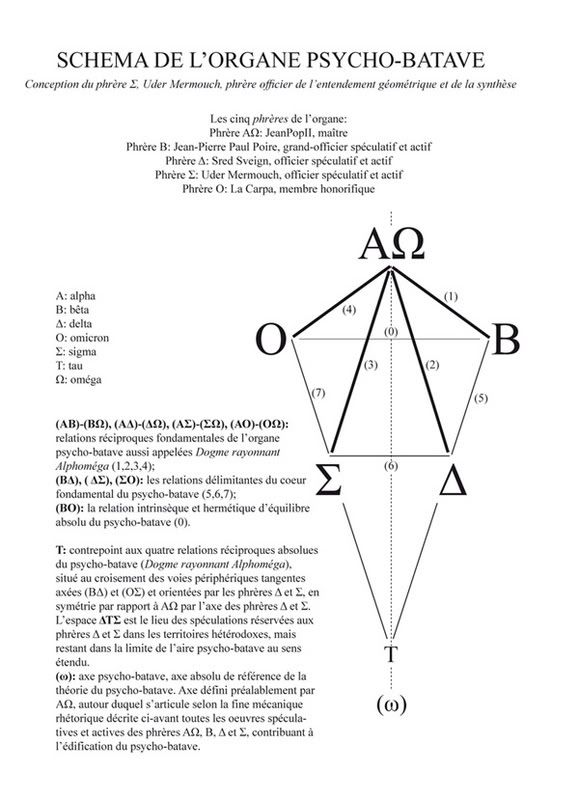
Ville de New York, Manhattan, quartier du Bowery, milieu des années 1970, un soir d'été.
L'atmosphère est étouffante, il fait chaud et l'air est si fortement chargé d'humidité qu'à chaque inspiration on a l'impression d'avoir le visage coincé dans un inhalateur qui serait fixé à un brumisateur tiède et sale. Il se fait tard, la circulation reste intense mais fluide. Les trottoirs sont parcourus par l'habituelle faune de cette heure dégueulasse. Petites frappes en jeans moulants, maillots de corps blancs maculés de sueur, chaînes arborées sur des pectoraux ostentatoires, ils traînent sur les perrons de pierre, la mine agressive. Des nanas passent, vulgaires, remontées et tendues comme des crotales prêts à attaquer, elles allument vicieusement la feinte passivité de prédateur des michetons, ils se retrouveront. Ailleurs, des teenagers surlookés, pompes de sports et vestes étroites, les cheveux en bataille s'attardent. Cà et là, quelques noirs en groupes compacts échangent bruyamment, parlent avec force gesticulations, se vannant savamment les uns les autres. La rumeur de la métropole est impressionnante, il n'est pas encore assez tard pour qu'elle baisse jusqu'à devenir tolérable. Nous sommes dans ce coin de Manhattan situé juste au nord de Little Italy, à l'ouest du East Village et à l'est de Washington Square déjà infréquentable à cette heure-ci. Ce n'est pas downtown, pas midtown non plus, nous sommes dans l'estomac de Manhattan. On entend parler partout un anglais rapide, truffé de tournures argotiques, extrêmement imagé et codé du côté des noirs, plus cinglant et direct du côté des italo-américains qui reluquent depuis les perrons tout ce qui passe. Les 'th' sont prononcés 'd' ou au mieux 't', tous les 'r' disparaissent. Toute cette salade humaine, bouge, vibre, d'une manière souple, comme bridée, car on sent chez la plupart de ces jeunes hommes, ils ont entre 15 et 25 ans, un cocktail de potentialités explosives qui à tout moment pourrait s'exprimer autrement que par l'idiome saccadé de New York. La rue est d'une couleur marronasse plombée, les trottoirs sont dégueulasses, la chaussée très inégale est couverte des cicatrices de travaux s'étant succédés sur des décennies, c'est pourquoi les voitures roulent lentement, dans chaque angle c'est le carnaval des ordures. Ici naviguent à vue tous les désoeuvrés qui sortent enfin après l'insupportable journée passée enfermés chez leurs parents – dans des 'tenements' bruyants de cris, de pleurs, de rires d'enfants, de récriminations féminines dans un italien marqué du mezzogiorno – tous prêts à se remonter à bloc. Ils ont déjà fait passer quelques anxyolitiques ultra costauds avec du whisky bon marché allongé de bière. Les noirs tirent nerveusement sur des cigarettes roulées très odoriférantes. Les inclassables teenagers ont des regards pleins de paranoïa, les pilules sans doute.

Nous remontons un peu la rue vers Houston Street puis Broadway, dans ce coin qui est un tout petit peu moins orthogonal que le reste de Manhattan. Houston Street marque le début de la zone orthonormée de Manhattan où les rues et les avenues sont numérotées, les avenues courant du sud vers le nord, les rues les croisant implacablement à angle droit. Nous débouchons sur Houston, artère importante où l'activité est maladivement fébrile à cette heure. Nous ne nous laissons pas étourdir et cheminons sur le trottoir sud au milieu d'ombres en mouvement, croisant dans toutes les encoignures de portes des statues aux poses dégingandées, certaines autres plus sculpturales contre des poteaux d'indication. En fait nous allons vers la station Broadway-Lafayette où passent de très nombreuses lignes de métro en provenance et à destination surtout de Brooklyn, du Bronx et de Harlem. Nous savons que nous y trouverons les deux individus que nous cherchons, chacun provenant de son 'borough' respectif par le métro. Ils se sont donnés rendez-vous là, à la sortie de la bouche sur Lafayette. De Brooklyn on peut venir ici directement par les lignes de l'IND: K, F, D et B, du Bronx par les lignes de l'IRT: 4, 5 et 6. La nuit est tombée assez vite, nous ne sommes qu'à 40° de latitude nord et maintenant cette fausse obscurité typiquement urbaine nous entoure. La nuit doit être somptueusement étoilée plus loin sur Long Island car le ciel est dégagé mais il ne nous présente ici, au fond des perspectives que nous croisons, qu'un ocre pâle des plus douteux. L'éclairage créé un archipel de macadam et de pierres sur lequel on n'arrête pas d'avancer, un peu effrayé par sa vulgarité, son ampleur, on saute de bloc en bloc. Quand on regarde bien ces couloirs, ces corridors que sont ces avenues et ces rues, on se sent pris comme une souris parcourant le fond d'une gouttière ou un réseau tels que ces dédales de laboratoire pour cobayes et l'on ressent très nettement, si on se laisse un peu trop aller un à la constatation, une onde d'angoisse sourdre de la nuque et nous parcourir. Sentiment ou sensation commune ici, on sait ce que c'est, on n'est finalement pas plus inquiet que ça, on va retrouver dans quelques minutes au croisement avec Broadway, Alan Vega et Martin Rev.
Arrivé au croisement on repère tout de suite Alan Vega qui, sorti de la station, arpente d'une manière si considérable un espace si réduit. On le repère non pas à cause de sa taille qui est modeste mais parce qu'il fume comme un sapeur et qu'à travers le nuage de fumée qui l'entoure il émane de son visage une sorte de furie. Son visage est assez rond, il a les pommettes larges, un nez busqué et de grands yeux sombres en amande. Un visage qui nous évoque à la fois les rives méditerranéennes du moyen-orient et quelque chose d'ibérique. Son ascendance est juive ashkénaze, des confins de l'Ukraine avec la Pologne et un peu séfarade, de le péninsule ibérique. Il émane quelque chose de peu rassurant de son regard et de ses gestes. Il a les traits marqués, tirés et son teint mat clair est terreux, gris, ce qui fait ressortir d'autant plus l'iris noir des ses yeux, qu'il darde un peu partout et dans lesquels on perd les pupilles. Il déambule à tort et à travers mais quasiment sur place, il trépigne, portant frénétiquement à ses lèvres épaisses une cigarette filtre sur laquelle il tire lourdement. Nous tombons vraiment en arrêt face à ce personnage car il s'agit bien d'un 'character' comme le dit l'anglais, associant en un mot limpide les caractéristiques à la fois physiques et " morales " d'une personne. Nous le connaissons un peu déjà, pour l'avoir vu lors d'une de ses nombreuses prestations dans un des centres indépendants d'artistes plasticiens qu'il fréquente, flanqué de Martin Rev depuis 1971. Martin Rev vient d'ailleurs d'apparaître. D'aspect opposé à celui d'Alan Vega, il est très grand, possède un visage longiligne encadré d'une chevelure bouclée hirsute et est habillé comme un teenager vaguement junky. Il paraît comme à son habitude complètement ailleurs, isolé dans une nonchalance qui, on est porté à le croire, cache une grande concentration au contraire de Vega qui à tous points de vue, possède une fâcheuse tendance à se diperser tous azimuts avec une énergie très mal dirigée. Il se sont vus et c'est bien sûr Vega qui se précipite vers son binôme et le salue. Très rapidement ils se mettent à échanger intensément tout en se dirigeant d'un train soutenu et quelque peu déséquilibré, vers le Bowery que nous venons de quitter.
Les deux sont en contraste autant à la vie qu'à la scène. Lors des quelques prestations fugaces auxquelles nous avons assisté, l'un était retiré derrière ses machines tandis que l'autre gesticulait aux marges du public, littéralement à sa face. Il nous faut parler un peu de ces sortes de performances qui ont commencé en 1971. Vega vient du vaste monde des arts plastiques, car il est originellement sculpteur. Il y occupait une place qui visiblement ne satisfaisait pas pleinement ses ambitions ou bien plus simplement ne convenait plus à ses visions. Ce monde était à cette époque un vaste marécage à la faune très complète. Comme dans le monde de la musique, les strates de cet écosystème présentent aussi bien de la boue que des hauteurs quasi célestes. Alan Vega semblait croupir quelque part dans ce milieu depuis trop longtemps à son goût. Il avait vécu un temps plus ou moins à la rue et cohabitait avec d'authentiques squatters dans les nombreux immeubles en état de déliquescence plus ou moins avancée qu'offrait la ville de New York. Il avait par ailleurs fondé une sorte de galerie, qu'il gérait, appelée The Project of Living Artists dans laquelle il semblait vivre maintenant.
Cette vie socialement en marge allait de pair avec une partie non négligeable de l'activité des arts plastiques de la ville, qu'on peut qualifier à juste titre d'underground. Alan Vega en faisait résolument partie et vivait donc dans un refus assez radical de ce qu'une majorité de ses concitoyens, vivait comme l'american way of life, vue à travers toute la planète comme le rêve américain. Alan Vega était foncièrement en incompatibilité avec cette vision très normative de la vie, le faisait savoir à qui voulait bien l'entendre et en conséquence vivait assez mal. Si Martin Rev vivait moins radicalement du fait de son tempérament peu enclin à la lutte ouverte, il n'en partageait pas moins le même dégoût de ce qu'offrait cette époque en terme de standardisation de modèle de vie. N'étant pas plasticien il ne bénéficiait pas des mêmes entrées que Vega dans certains des égouts de l'underground. Il vivotait assez tranquillement, dans son non moins délabré Bronx natal, prêtant ses qualités de musicien, compositeur et interprète lors d'un tas de prestations alimentaires, s'occupant obsessionnellement de ses claviers et de ses boîtes à rythmes. Il jouait notamment du piano électrique pour le groupe Reverend B. qui fréquentait avec les New York Dolls, Blondie ou encore Television la galerie de Vega. Il faut ajouter que Martin Rev apaisait quelque peu son être beaucoup moins simple qu'il le laissait paraître en faisant un usage assez peu modéré de sédatifs opiaciés, Vega se référait parfois à lui en l'appelant malicieusement 'Tree of weed' que l'on traduira librement « arbre à came ». Il faut ajouter à cela qu'Alan Vega absorbait quant à lui des quantités non négligeables d'alcool qui ne faisaient qu'exacerber sa colère.

Les deux se retrouvaient pourtant sur les mêmes scènes à jouer un spectacle sonore déroutant et pour le moins nouveau. Certains en étaient immédiatement dégoûtés et le faisaient savoir, d'autres fascinés et intrigués regardaient et écoutaient. Ils voyaient, médusés, un Alan Vega furibard, hurler des propos néo-beat tour à tour obscènes et enjôleurs, comme des slogans d'une nouvelle ère, alors qu'ils entendaient, quelque part derrière lui, provenir des claviers et boîtes à rythmes de Martin Rev, absolument statique et concentré, un quasi mur sonore. Ils jouaient rarement plus d'une vingtaine de minutes, le temps que certaines personnes plus excédées que les autres commencent à répondre physiquement aux provocations d'Alan, en lui envoyant tout ce qui se trouvait à leur portée, à quoi il répondait, tandis que Martin continuait inlassablement à frapper ses rythmes industriels et nourrir son mur sonore jusqu'à ce qu'Alan vienne le sortir de son hypnose en lui disant qu'il allait falloir arrêter là. Alan Vega avait bel et bien commencé à filer un coton qui pourrait satisfaire à de nombreux chefs ses vues artistiques. Aussi bien dans son rapport au monde, qu'esthétiquement, il y avait là quelque chose d'inédit dans sa radicalité. De rares spectateurs l'avaient compris, il courait des bruits qui commençaient largement à déborder le milieu des squats pseudo artistiques et des galeries plus ou moins informelles pour se répandre dans d'autres sphères, celles du non moins marécageux milieu de la musique pré-punk de ces années là. Un milieu qui caressait l'espoir de transgresser certains canons voire de transmuter le genre.
Nous ne nous y étions pas trompés, ce que nous avions vu et entendu était bel et bien inédit et perfectible. Il était tout à fait possible que ces deux là offrent enfin une réponse musicale à la putréfaction généralisée des sphères aussi bien créatives que civiles. L'association stupéfiante du ton rockabilly de Vega à la musique parfaitement mécanique et hypnotique de Rev, donnait un ensemble rigoureusement conceptuel et transgressif au plus haut point. Beaucoup n'y comprenaient rien, ou ne voulaient rien y voir d'autre que foutoir sonore et défoulement psycho-pathologique de Vega. Au fil du temps Vega et Rev sortirent un peu de l'ornière des obscures performances 'arty' pour donner des prestations sur des scènes plus ouvertes de Manhattan. Les réactions n'étaient guère différentes, mais la part des gens interloqués qui faisaient l'effort de s'interroger croissait. C'était une époque résolument post hippie, l'époque du nouveau Max's Kansas City près d'Union Square, du CBGB, situé sur le Bowery, quartier que nous avons traversé tout à l'heure. La plupart des gens fréquentant ces lieux auraient déclenché chez un citoyen lambda d'âge mûr une sensation réflexe très animale, mélange de peur et de violence physique, un réflexe d'autodéfense. Il n'était pas rare dans ces lieux d'avoir à enjamber des corps en pleine salle, mais cette faune ne déparaillait pas dans le coin. Pour une bonne part on rencontrait pas mal de véritables loques et déchets humains à travers toute l'Amérique schizoïde d'alors. Seulement là, se jouait ce que la gestation musicale de cette ville inséminée par ces temps allait accoucher de plus pertinent. Parmi la cacophonie du moment on pouvait discerner ce qui allait devenir un punk new-yorkais autrement solide que son parodique et minable célébrissime pendant londonien et surtout des mouvements ou 'vagues' réellement indépendants (qui allaient générer de nouvelles chapelles), embryons de la future new wave et de la symptomatique no wave subtilement déstructurée et noisy. On pourrait évoquer les Ramones, les Fleshtones, des pesonnalités telles que Richard Hell ou Lydia Lunch etc. Pour ceux qui étaient trop fatigués, vaincus ou désabusés, l'époque était ouvertement à la souillure. Aucune ère n'avait jamais offert autant d'opportunités et New York était LA ville réceptacle de tout ce que l'Amérique comptait de branques, loufoques, démagos et mégalos. Dès lors, la déperdition au coeur de toute cette humanité obnubilée en marche donnait un spectacle qui n'était pas beau à voir. Mais la ville possédait un pouvoir autrement positif et indubitable, celui de catalyser. De sorte que le printemps d'une frange de tous ces corps et esprits en lutte réglée avec leur temps allait fleurir. Alan Vega et Martin Rev, en étant assez frappés pour ne pas disparaître corps et âmes au milieu de la cohue, allaient faire l'expérience jusqu'à son terme regénérant. Si eux mêmes allaient être marqués par certains précipices sur lesquels ils s'étaient penchés, leur musique allaient émerger, définitivement différente, de cette décennie prolixe en rébellions sonores, comme un manifeste syncrétique.
Leur association avait pris le nom de Suicide, ce que nous considérerons comme une marque ironique d'espoir en ces temps si lugubres. « Suicide a toujours eu à voir avec la vie. Mais nous ne pouvions vraiment pas appeler le groupe Life. Alors nous l'avons appelé Suicide justement parce que nous voulions revendiquer la vie. » (Alan Vega, 1985).
Suicide faisait vraiment peur, y compris aux Punks. C'était trop pour eux, trop conceptuel, trop minimaliste, trop loin de cet immédiat besoin de satisfaction propre aux toxicomanes, trop plein de ce bruit électrique bizarrement modulé par un Rev pas du tout démonstratif, trop riche de toutes ces références qui pointaient dans les propos de Vega. Bref, ils nous jouaient des pièces sonores terroristes qui n'épargnaient personne. Ce 'primal duo' comme ils aimaient se qualifier eux-mêmes avait malgré tout suffisamment éclairé de sa lumière électrique la vision de certains producteurs qui allaient fonder le label Redstar. Martin Thau et Craig Leon allaient les produire et éditer leur premier LP éponyme à la fin de l'année 1977 puis, les manager.
Cet album de sept titres, inaugurant le label, présentait les morceaux suivants: Ghost Rider, Rocket U.S.A., Cheree, Johnny, Girl, Frankie Teardrop, Che, fruits d'une élaboration mûrie depuis 1971. Tous ces titres sont devenus des classiques d'une sorte d'avant-garde rare, celle qui ne se vivait pas comme telle. Alan Vega précisera qu'il n'avait jamais été question pour lui d'avant garde mais d'un travail littéral de génération du son de New York. Aujourd'hui encore l'écoute de l'album Suicide reste un choc, constitué des arides mélodies de Rev, essence réminiscente de la fin de l'ère industrielle occidentale associée à l'épiphanie incantatoire rockabilly de Vega. Ce genre de choc que l'on peut vivre en découvrant une personne qu'on côtoyait depuis longtemps sans l'avoir remarquée et qu'on dinstigue un beau jour comme un être extrêmement intéressant auquel on sait que l'on va s'attacher dangereusement, un retour introspectif dans son être et sa temporalité.
Cet opus connu, à sa sortie, un unanime succès d'estime mais dût attendre la fin des années 1990 et une réédition en Grande-Bretagne pour connaître un véritable succès commercial. Or cet album dès sa parution en décembre 1977 allait sortir le 'primal duo' des trop précieux marasmes du rock New Yorkais en l'électrocutant. Cet album allait être le manifeste choc, la déclaration péremptoire, la thérapie lourde d'un ensemble de genres aux cousinages incestueux croulant sous les posture égotistes et la mauvaise foi. Il représentait une ouverture, un destin, des frontières à redessiner afin d'être dépassées à nouveau. Une sorte d'épiphanie de ces temps dépourvus d'humour et d'espérance. C'est pourquoi il allait présenter même durant la décennie de cire suivante cette surprenante vitalité, cette nouveauté saisissante qui perdure jusqu'à nos jours. Il allait être l'une des oeuvres les plus nobles de l'histoire du rock, l'une des pierres angulaires de sa rééidification.
UDER MERMOUCH, 6 juin 2007
La ville de Minneapolis forme avec sa voisine St. Paul une entité urbaine communément appelée "Twin Cities". Seule aire urbaine d'envergure nationale de l'Etat du Minnesota, situé en marge du 49e parallèle nord, frontière historique entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique. L'Etat est situé à l'ouest de la région des grands lacs, les températures y sont extrêmement rigoureuses, glaciales pendant la majeure partie de l'année, moites durant un rapide été. Minneapolis-St. Paul la cité double se trouve dans un recoin d'une Amérique agricole et sauvage à l'horizon géométrique dans sa partie sud, barrée de montagnes noires d'arbres sévères au nord. Des espaces placés sous le signe trouble de l'eau qui macule son relief d'innombrables lacs d'un bleu rigide. Des espaces peuplés et cultivés par de tenaces et taciturnes luthériens d'ascendance germanique ou scandinave.
Nous y sommes loin, très loin des vibrations cacophoniques de la côte est, loin de celles plus proches mais plus erratiques de celles de villes du midwest telles que Chicago ou Detroit, très loin également de l'univoque sérénité des grandes plaines, très loin aussi de la torpeur du vieux sud, en aval du Mississippi qui coule pourtant en ces lieux. Ce fleuve qui traverse les deux villes, y est déjà très puissant. Le glauque de ses eaux glacées, opère un constant et tranchant rappel de l'écrasante hostilité minérale de ces terres aux citoyens de Minneapolis-St. Paul qui le traversent ou le longent au volant de leurs véhicules de métal, puissants et bridés. Cette évocation est sans appel en tout temps de l'année et les habitants de ces lieux ne s'y trompent pas, ils se sont résignés à l'ignorer, ils regardent en eux ou se perdent dans des perspectives fuyantes. Minneapolis dont l'étymologie est formée de la même racine indienne Dakota 'mni' (eau) qui a donné son nom à l'Etat et de celle grecque de 'polis' (ville), renvoie encore à la puissance de ces eaux.
Ces habitants sont enveloppés par le vaste organisme qu'est cette ville-double. Un organisme qui, sans le caractère implacable des terres où il est situé, s'il n'est pas tout à fait hostile est hiératiquement indifférent. Un organisme constitué d'organes de pierres, d'acier, de béton, séparés par des voies tirées au cordeau que les citoyens parcourent enfermés dans l'habitacle de leurs automobiles parce qu'il fait définitivement trop froid dehors et que le chemin à parcourir pour atteindre la zone industrielle, le bureau ou le rare et contraint lieux de loisirs est toujours trop long. La neutralité des édifices ne perturbe pas le trajet des citoyens de l'unique métropole de cet isolé septentrion maintenant conquis et parcimonieusement habité. Les limites administratives mêmes collent à la raisonnable géométrie adoptée pour mieux cerner et domestiquer le globe. Parallèles et méridiens, cercles vus par les hommes comme de parfaites droites. Les diagonales sont ignorées, tout peut être vu comme parallèle ou au mieux tangent. Sur tout cela règne un ciel qui peut être dégagé, bleu, vierge, simple rappel de l'immensité du vide qui nous sépare de cette apparente voûte qui ne retient ici aucune chaleur et par lequel arrivent trop souvent d'interminables précipitations.
La ville-double ne siffle ni ne vrombit, elle bat, lentement et lourdement d'un pouls solide et industriel. Un pouls à l'origine artificiel mais maintenant ineffable pour les êtres qui vivent à son rythme. Les hommes oeuvrent d'un labeur d'insectes au sein de tentaculesques usines ou perchés dans les alvéoles des tours d'affaires des deux downtowns, ils vont et viennent, flux et reflux à heures fixes de ces organes actifs vers les vastes étendues indifférenciées d'habitations standards qui composent l'essentiel du corps étalé de cette entité urbaine. Un très vaste tissu, fait de cellules labiles, qui présenterait à un oeil aérien une exemplaire hyperplasie. Un nombre non négligeable de ces citadins s'arrêtent en chemin et pénètrent dans des débits de boissons où ils s'adonneront jusqu'à la fermeture à la substance éthylique qui les réchauffera, les divertira de ce décor ostensiblement indifférent, ils pourront faire tourner quelques disques dans le juke-box et ils pourront prendre le temps de porter un regard sur leurs congénères chez qui ils rencontreront comme un reflet...

Quelque part en ces lieux, à la fin des années 1960 se trouve un jeune homme discret d'à peine vingt ans, dont on ne sait quasiment rien. Nous savons cependant ce qu'il fit de son sens de la musique qu'il voulut partager avec les hommes. Ce jeune homme s'appelle Michael Yonkers, il est natif de Minneapolis-St. Paul, nous ne savons duquel des deux pôles qu'on ne saurait dissocier. Il joue de plusieurs instruments à cordes, frappées et pincées. Il écrit des chansons, les compose et les interprète en compagnie de son jeune frère et d'un ami. Il a des connaissances suffisamment poussées en électronique pour en user dans la genèse et le jeu de son expression musicale. Il suit des cours à l'Université et passe ses loisirs à jouer ou à bricoler ses instruments dans la cave de la demeure familiale qu'il a d'ailleurs transformée très humblement en un honorable studio d'enregistrement et de mixage.
Ce jeune homme est d'une taille moyenne pour un américain de souche anglo-saxonne, il a le visage grave et les traits fins, son corps est d'une robustesse pondérée, ses cheveux raides qu'il porte longs sont blonds. Souffrant d'une myopie moyenne il porte une paire de lunettes à verres concaves, assez épais, optique de l'époque oblige, afin de corriger sa dioptrie trop convergente; de sorte que derrière ces verres ses yeux sont un peu lointains, ils portent un regard qu'il a calme, pénétrant et comme retiré de manière avertie dans certaines profondeurs.
Sa musique nous est parvenue dernièrement. Elle nous est venue de cette Amérique dolente, de cette cité double, des années 1968 et 1969, sous la forme d'un album de treize titres, intitulé Microminiature Love. La substance de cet album est le fruit du travail de Yonkers durant la seconde moitié des années 1960, travail qu'il avait compilé et préparé en vue de la sortie d'un album de sept titres à l'automne 1968 sur le label local Sire. Un ensemble de compositions qu'il jouait un peu partout depuis quelques années sur diverses petites scènes à travers sa ville double. Cet album initial n'a jamais vu le jour car pour une raison indéterminée, l'entente a été rompue avec ce label et l'album fut remisé au placard. L'ensemble, qui comprend les sept titres initiaux et six autres enregistrés lors d'une unique session dans le home studio de Yonkers au printemps suivant de 1969, a finalement été exhumé par le label Destijl et a paru au début des années 2000 sous le même titre Microminiature Love. C'est sous cette forme que son travail nous a atteints et éblouit. Sans aucune information sur l'homme, nous nous sommes étourdis à l'écouter nous parler, de si loin et nous atteindre de si près. Traversant les trente-huit ans nous séparant, son travail, s'est adressé directement à nos coeurs et à nos âmes. De la première écoute jusqu'à ces instants ou nous écrivons ces lignes, l'oeuvre portant le nom de Microminiature Love, signée Michael Yonkers a imprimé de sa marque nos coeurs et nos âmes, s'installant profondément en nous tel un double attentif. Parmi tous ces morceaux aucun ne déroge à l'étrangeté contenue caractéristique du travail de Yonkers, cette rigoureuse économie dans le rapport fond/forme, armature inébranlable sur laquelle vient s'exprimer la chair expressive des sons. Nous entendons toujours la voix de tête de Yonkers si lointaine et si finement modulée accompagner puissamment un jeu à la sobriété tordue frictionnant la rugosité de l'accompagnement. Il nous fait don d'un univers sonore d'une richesse et d'une profondeur précieuses portées par une concentration audacieuse sur ses graves propos. Nous avons trouvé aussi loin que nous ayons eu le loisir de parcourir cette dense matière ressuscitée, une même singulière identité s'exprimant, se déployant, se renouvelant sous des arguments différents dans chaque titre. Nous avons trouvé de ces choses rares, que le temps n'érode pas, les éléments irréductibles de cette matière qui compose les métaux précieux.
Uder Mermouch, mai 2007