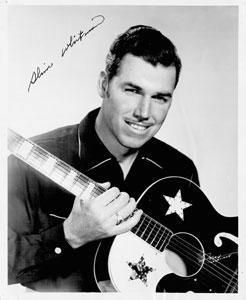Je n’ai jamais su raconter les histoires. Au contraire de celles de Demetrius, captivant conteur à la limite du monologue carnavalesque, mes paroles sont sèches comme la paille. Je ne sais transmettre que des émotions, et ces coups de sang ne seraient que flaque inerte en moi si je ne pouvais les partager. Je connais Demetrius depuis un an maintenant et je sais notre complémentarité d’ordre presque utilitaire. Il me raconte les histoires que suis chargé de vivre, pour que je puisse aussitôt après les lui confirmer.
Quand il m’a chargé de ce voyage Californien, je suis certain qu’il avait derrière la tête de me convaincre une fois de plus de l’inanité irréparable de la scène de San Francisco. Tel était son plan : me faire suivre la côte pacifique du sud au nord pour, à mesure que j’approcherai de San Francisco, me dégoûter par contraste et définitivement de cette ville, dans laquelle il n’a jamais posé les pieds. Je n’y ai séjourné qu’une fois, très jeune, autour de ma mère et ignoreux du reste, et j’en gardais une impression de vétusté immobile et l’odeur cuivrée du vent d’octobre, en un angoissant matin sans fin. Mais j’étais déterminé à relever le défi, convaincu qu’il y aura toujours plus à vivre qu’à dire. Je sais que du nord au sud, du fog au désert, des séquoias aux palmiers, des otaries aux pélicans, la Californie est affaire de plusieurs continents, et de nombreux soleils.

Première étape : J’atterris à San Diego, puis retrouve la voiture de location que Demetrius m’avait réservé sous un malicieux nom d’emprunt. Etrangeté : D’où sont tombées ces sept gouttes de pluie sur mon pare-brise ? Jetées par un ciel orange qui les a aussitôt rappelées à lui. A ma droite, à ma gauche, des hommes modérément affairés, que ne distraient pas les avions bas. Les maisons sont tassées comme du chaume et laissent des interstices soufflant poussière qui magnétisent l’œil en un éternuement. Pourtant tout est ouvert à perte de vue et la richesse confortable de ces hommes n’attise que l’imagination.
C’est ici que les héros Psycho-Bataves The Hard Times ont laissé mûrir leurs chansons, grappes émeraudes hiératiques sous le soleil figé. Tout dans leurs chansons invoque la quiétude de l’immédiat après-midi, posé sur le sable, constellé d’éclats marins. Je pense parfois en les écoutant, et malgré la richesse de la production, aux Arizoniens The Grodes, libellules inquiètes dans le désert… Mais dans les morceaux de The Hard Times, empreints d’une égale discrétion classique, les midis se succèdent mais n’abîment pas le cours des semaines, et si parfois on meurt, on disparaît sans drame. Le plus troublant morceau du groupe, « Under the sunlight », ne perpétue pas la fatalité des peuples natifs mais dessine une nouvelle page chromée du train, parfois fantôme, de l’existence. Même si les arrangements trahissent des efflorescences plus complexes, on reste loin aussi du baroque mexicain, à l’image de la Fascinante Old Town de San Diego, paisible décor de western qui ne prend pas la peine de dissimuler ses sobres oripeaux.
C’est également de cette manière qu’il faut envisager l’art de l’étonnant groupe vocal mixte The Deep Six. Ce qui leur permet de se préserver une identité malgré un album essentiellement constitué de reprises, c’est le soleil. Le soleil gourd, orangé pacifique, qui en quelque sorte caramélise les chansons, leur infuse cette saveur de melon et de poivre.
Ici, ma vue est brouillée, les reflets de ce soleil bonificateur dansent devant mes pupilles dans une horizontalité amnésique.
Il faut pourtant prendre la route du nord.
le 7 juillet 1967
The Hard Times - Take a look around
The Hard Times - Under the sunlight
The Deep Six - What you wish from the golden fish